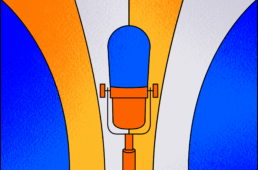
Disponible à l’écoute sur Deezer et Spotify !
Nous avons souhaité mener un travail de collecte de témoignages en lien avec le son. Nous avons donc travaillé à la réalisation d’une série de podcasts produits par la Ferarock. Elle se décline en plusieurs épisodes pour revenir sur l’histoire du SMA et les principales thématiques qui l’ont traversée.
2005 : Tik tok, Spotify et Deezer n’existaient pas, mais c’était l’âge d’or de myspace, les débuts de Youtube, de la TNT et de BFM TV. C’est le « vous en avez assez de cette bande de racaille, et bien on va vous en débarrasser ». 2005 ce sont aussi les morts tragiques de Zyed Benna et Bouna Traoré, ainsi que les trois semaines de révolte qui suivront. Et alors que la France connaît ses plus grosses émeutes depuis mai 68, on assiste à un essor des festivals et des scènes de musique, partout sur le territoire.
Le besoin de se rassembler émerge. Les salles de concerts membres de la Fédurok et de la Fédération des scènes de jazz décident alors de créer leur syndicat.
Ce sera le SMA : le Syndicat des Musiques Actuelles.
20 ans plus tard, on fête une aventure collective, l’engagement, les luttes menées, et tout ce qu’il reste encore à préserver et à accomplir. C’est à découvrir tout au long de cette série de podcast en six épisodes.
Un podcast produit par la Ferarock, écrit et réalisé par Elina Deschere
Episode 1 – La machine est lancée
Tour à tour, Philippe Berthelot, Olivier Galan, Pascal Chevereau et Eric Boistard racontent comment ils ont œuvré, aux côtés également de Michel Audureau, à la création du syndicat, né de l’envie de rassembler autour de valeurs fortes et de porter les revendications de la filière, dans la joie et dans la lutte.
Episode 2 – Le SMA au pied levé
La notion de crise renvoie à un événement brutal, une rupture mais elle est aussi synonyme de résistance. Et c’est bien là que se positionne le SMA. Par leur ampleur, leur réseau et leur structuration, les syndicats sont en première ligne dans ces situations. Et si les crises sont souvent révélatrices d’un système défaillant, elles peuvent aussi générer une émotion collective forte qui met en avant le principe de solidarité. Alors, quelle union pour quels combats ?
Merci à Laurent Decès, Karine Daniel, Yann Rivoal et Frédéric Hocquard pour leurs témoignages.
Episode 3 – L’indépendance comme étendard
Les acteurs et actrices des musiques actuelles assument des fonctions d’accompagnement et de soutien aux musiques émergentes. Les structures adhérentes au SMA défendent ainsi un modèle de gestion désintéressée et de « lucrativité limitée ». Car le secteur musical ne se limite pas à la production et à la diffusion d’œuvres musicales conçues comme de simples biens ou services consommables, mais il permet d’affirmer des valeurs fortes, telles que l’utilité sociale, la solidarité et l’indépendance.
Merci à Frédéric Maigne, Benoît Chastanet, Stéphane Krasniewski et Lisa Bélangeon pour leurs témoignages.
Episode 4 – Une place à prendre
La musique est souvent racontée comme un miroir de la société et un support pour l’histoire. Pourtant, il y a un écart entre la promesse d’un secteur en avance sur son temps, la réalité des inégalités qui persistent et sa fragilité face aux transitions écologiques. Et si la musique peut construire et transformer nos imaginaires, la filière ne doit pas être déconnectée de la réalité.
Comment faire en sorte que le secteur musical contribue à forger les identités de chacun et chacune, et à construire une société émancipatrice et durable ? Et si les artistes sont bien souvent les porte-paroles d’injustices sociales, qu’en est-il des structures qui les soutiennent ? Comment intègrent-elles les enjeux d’égalité, de diversité et d’écologie au sein de leur travail ?
Merci à Anne-Lise Vinciguerra, Béatrice Desgranges, Marion Robinet et David Irle pour leurs témoignages.
Episode 5 – L’art à l’épreuve
Menaces de fermetures de salles de spectacle, annulation d’événements, baisse de subventions, pression et censure sur les programmations… Les atteintes aux libertés de création et de programmation sont de plus en plus fréquentes et s’accompagnent d’une forte progression des idées d’extrême droite. La polarisation de la société tend à élargir la fenêtre d’Overton, ce concept qui définit ce que l’opinion considère comme acceptable et discutable dans la sphère publique. Ce glissement rend les entraves aux libertés entendables pour une partie de la société.
Mais d’autres voix s’unissent pour souligner la menace que représente l’arrivée de l’extrême droite dans le milieu culturel, et résistent à la banalisation de ces idées. Quelles stratégies adopte l’extrême droite ? Pourquoi et comment organiser la riposte ?
Merci à Aurélie Hannedouche, Marion Rouxin, Clara Steg, Sylvie Robert et Nora Hamadi pour leur témoignages.
Episode 6 – Et dans 20 ans ?
En 2025, le SMA fête 20 ans de mobilisation au service de la filière des musiques actuelles. Le syndicat compte aujourd’hui plus de 600 structures adhérentes : festivals, salles de concert, producteurs de spectacle, labels, radios ou encore réseaux, fédération et organisme de formation.
L’évolution de nos sociétés démontre qu’il ne suffit plus aujourd’hui de citer le mot inclusion dans un édito, de parler de création pour la défendre, ou de compter sur la passion des acteurs et actrices du secteur pour répondre aux changements. Il est temps d’aspirer à plus de collectif, témoigner de la diversité et repenser les métiers du secteur afin de construire un avenir désirable et durable.
Le 15 septembre 2025, au 106, à Rouen, s’ouvre le congrès annuel du SMA. Pendant trois jours, il sera abordé et débattu divers sujets d’actualité dont la qualité de vie et les conditions de travail, l’intelligence artificielle et la lutte contre les inégalités ethno-raciales.
Le point commun à ces trois sujets ? C’est qu’au sein des musiques actuelles, on n’en parlait pas, ou peu, il y a 20 ans.
Merci à Sarah Battegay, Xavier Perdrix, Pierre-Mary Gimenez-Guillem, Alexandre Cazac, Aura Burzynski, Solange Maribe et Laëtitia Coquelin pour leurs témoignages ainsi qu’à toutes les personnes des structures adhérentes au SMA qui ont apporté leurs paroles.